
La plongée sous-marine

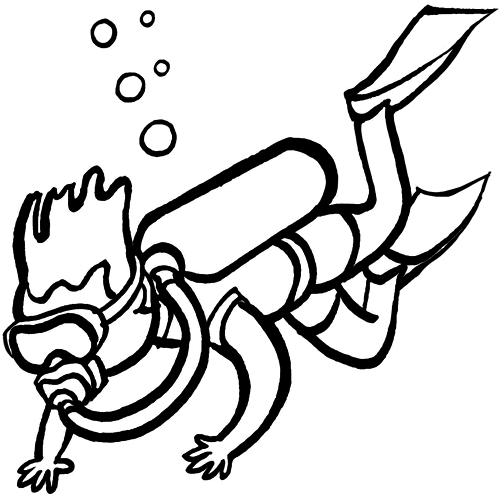
TOXICITE DES GAZ
Etude de cas
Anette voyage en Afrique du Sud pour faire de la plongée à Sodwana Bay.
Arrivée au centre de plongée, elle voit que l’état du matériel prêté aux plongeurs laisse à désirer.
Toutefois, elle décide de plonger quand même ; la flore et la faune sous-marine sont censées être merveilleuses, et d’ailleurs, qu’est ce que ça peut bien faire s’il y a un peu de rouille.
A peine descendue elle commence à avoir de violents maux de tête et elle se sent essoufflée. Anette continue, car elle vient de voir une énorme tortue, mais elle est obligée de s’arrêter et d’abandonner sa plongée, tellement elle est malade…
Explication : Il y a des polluants qui ne sont pas forcement dangereux en air ambiant, mais qui peuvent être une source d’intoxication en plongée.
La pollution des gaz respiratoires par le monoxyde de carbone (CO) ou le gaz carbonique (CO2) dont la toxicité est amplifiée par la pression peut avoir des conséquences mortelles pour le plongeur.
En effet, il y a une loi physique qui est impliquée dans ce processus - la loi de Dalton, qui régit la pression partielle d'un gaz
La loi de Dalton
« La loi de Dalton définit que la pression totale exercée par un mélange est égale à la somme des pressions partielles des constituants. Cette loi est une conséquence de l'équation des gaz parfaits.
P=∑ PP
Cette loi peut être mise en évidence avec l'expérience de Bertholet:
"On place deux gaz distincts dans deux mêmes volumes à une même pression reliés entre eux. A l'ouverture de la liaison, on constate que les deux gaz se répartissent uniformément dans les deux volumes en conservant la pression initial.”
Symptomes de toxicité
Anette était victime d’une intoxication au gaz carbonique liée à la pollution de l’air dans la bouteille du à un mauvais gonflage de la bouteille de plongée (qui est souvent le résultat d’une mauvaise maintenance du compresseur). L’essoufflement qu’elle a ressenti s’appelle aussi « hypercapnie ».
Donc nous savons maintenant que les gaz respirés sous pression peuvent devenir toxique. Ils peuvent engendrer d’autres symptômes de toxicité comme la narcose.
Etude de cas
Un plongeur nous parle de son expérience :
“Depuis le début de la saison, nous enchaînons les plongées profondes quotidiennes.
Chaque jour, c'est -50m minimum, mais souvent -70m, voire -80m.
Nous connaissons donc tous les jours la narcose, « l’ivresse des profondeurs »
dont a parlé très tôt le Commandant Cousteau qui rapporte dans son livre « le monde du silence » des épisodes tragiques liés à ce phénomène : perte du raisonnement, perte de connaissance entraînant la noyade.
Conscients du danger, c’est chaque fois avec prudence que nous franchissons la barrière des 50m qui marque, pour la plupart d’entre nous, les débuts des premiers troubles.
Cette limite varie selon les individus.
Certains sont narcosés dès les 40m, d’autres pas avant 60m, et cela avec des degrés d’intensité variables liés à la fatigue, à l’effort fourni sous l’eau, à l’état psychique, ou à l’entraînement.
Car il est vrai que, comme pour l’alcool, il existe une sorte d’accoutumance à cette « ivresse ».
Avec l’habitude, on sait vers quelle profondeur les premiers symptômes apparaissent.
On y est attentif et dès leur apparition, sachant qu’on est « bourré »,
on se maîtrise et on essaie, dans la mesure du possible, de se concentrer sur chaque geste afin d’éviter que notre esprit embrumé ne nous fasse commettre une erreur fatale.
L’ivresse des profondeurs possède sur l’ivresse de l’alcool l’avantage de n’avoir pas de suite. Dès que le plongeur intoxiqué remonte de quelques mètres,
son cerveau s’éclaircit sans laisser la « gueule de bois ».
J’avoue en aimer la magie et en même temps, je la redoute
car je sais qu’elle amoindrit dangereusement l’instinct de conservation.
Pour certains, les effets se manifestent par des troubles auditifs (bruit de cloches sonnant à la volée – sifflet de locomotive) , pour d’autres une angoisse insurmontable qui les conduit à tout larguer pour en sortir.
Pour moi, les troubles sont surtout visuels (objets déformés), olfactifs (goût métallique dans la bouche) et, curieusement, l’installation d’une fonction prémonitoire extraordinaire.
J’ai vraiment pris conscience de ce phénomène lors de cette plongée profonde
du jeudi 14 août 1975, au large du Cap Charraca, à Ibiza.”
La narcose, aussi appelé « ivresse de profondeurs » est une intoxication du sang par le gaz utilisé lors de la plongée. Le plus souvent il s’agit de l’azote qui a un pouvoir narcotique élevé.
L’intoxication résulte de l’augmentation de la concentration du gaz dans le sang lors de l’augmentation de la pression au moment de la descente.
La narcose est donc un trouble causé par la pression – elle influence tous les mammifères à des pressions différentes.
Et le dauphin alors...
En effet, lorsque le dauphin se retrouve hors de l'eau, le poids de son corps lui écrase les poumons, il devient alors inconscient l'empèchant de forcer sa respiration, elle va donc devenir plus lente puis irrégulière pour s’arrêter, son rythme cardiaque va s’effondrer. La narcose est une mort pénible par asphyxie.
Revenons à l'humain
Qui dit pressions différentes, dit aussi profondeurs différentes : certains plongeurs font l’expérience de la narcose dès 30 mètres (4 bars), d’autres à des profondeurs plus importantes. Généralement les plongeurs sont victime de l’ivresse de profondeur autour de 40 mètres (5 bars).
Les signes et symptômes de la narcose variant en fonction de l’individu et de la profondeur de la plongée:
-
une légère euphorie (10 – 30m)
-
altération des capacités de raisonnement, de mémoire (vers 30m)
-
hilarité, idées fixes, confiance excessive en soi, incapacité de réaliser un calcul simple (30 – 50m)
-
somnolence, hallucinations, altération des facultés de jugement (vers 50m)
-
hystérie ou angoisse (50 – 70m)
-
confusion mentale (70 – 90m)
-
perte de connaissance (vers 90 m)
-
la mort (au delà de 100m)
On a même déjà vu des plongeurs qui voulaient passer leurs détendeurs aux poissons !
Pour surmonter ce problème l’homme a développé divers mélanges d’air pour limiter les caractéristiques toxiques de l’air respiré pendant la plongée, p.ex. le nitrox, l’hélium ou encore le trimix.
Les mélanges d'air
-
L'air est un mélange composé de N2 et de 02
-
Le Nitrox est un mélange respiratoire (binaire) suroxygéné composé d’02 et de N2 différent de l’air.
-
Héliox : Hélium + Oxygène
-
Le Trimix est un mélange respiratoire (ternaire) composé d’O2 de N2 et (He) d’Hélium.
-
L’Héliair est un mélange respiratoire composé d’hélium et de l’air. Attention le mélange peut être hypoxique Ex : 25 % d’He + 75 % d’air
[0.75 x 20 % d’02=15 % 02 (< à 16 %)]
-
Hydréliox : Hydrogène + Hélium + Oxygène
(Plongées à saturation, plongées professionnelles)

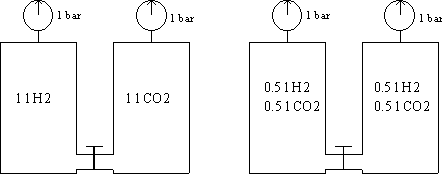
Anette plongeant avec une tortue
Schéma de l'expèrience de Bertholet
Exemple : comparaison entre la composition de l'air et celle du Nitrox
