
La plongée sous-marine

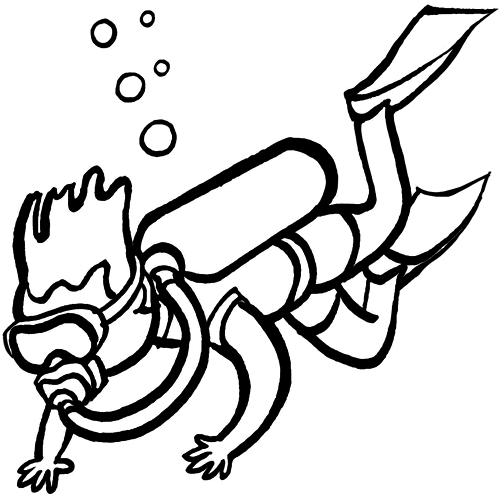
LES POUMONS
Etude de cas:
"John est un homme de quarante ans, très sportif, qui ne fume pas. Il court des marathons régulièrement et fait également trente kilomètres à vélo au moins une fois par semaine. Il a une alimentation équilibrée et est donc en bonne santé. Récemment, une visite chez le médecin a confirmée son bon état de santé et son aptitude à toute pratique sportive. Pour les vacances de Noël, il décide de partir en vacances en Thaïlande avec toute sa famille. Au bord de la plage, il décide d’aller faire de la plongée sous-marine avec sa famille. Tous excités, ils s’inscrivent à un baptême de plongée organisé le lendemain. Après avoir passé une bonne nuit, ils se rendent au centre de plongée et apprennent les rudiments de la plongée sous-marine. John est anxieux et tendu à l’idée d’effectuer sa première plongée. Les instructeurs vérifient l’ensemble du matériel et s’assurent de son bon fonctionnement. Ils se rendent sur le site de plongée et plongent finalement. Ils atteignent une profondeur de 10 mètres.
Au moment de la remontée, John éprouve des difficultés à respirer. Il ressent des douleurs au niveau des poumons, devient pâle, a du mal à communiquer et souffre de troubles de la vision. Sa situation se dégrade rapidement quand il sent du sang dans sa bouche. Il finit par perdre conscience. Un instructeur réussit à le remonter à la surface, ou un autre instructeur peut lui prodiguer les premiers secours. "
Que s’est-il passé ? Qu’est ce qui a déclenché cet accident de plongée ? Est- ce un phénomène qui aurait pu être évité?
Lors d’une plongée sous-marine, deux accidents principaux peuvent survenir au niveau des poumons : une surpression pulmonaire ou une dépression pulmonaire.
La surpression pulmonaire:
La surpression pulmonaire survient lorsque la respiration du plongeur est bloquée lors de la remontée d’une plongée en bouteilles. Ce phénomène engendre une dépression qui bloque l’air inspiré dans les poumons. La respiration du plongeur peut s’interrompre pour différentes raisons : l’apparition d’eau froide dans les voies respiratoires, le renvoi de gaz dans l’estomac, la panique du plongeur, ou un spasme de la glotte. La surpression pulmonaire est un des accidents les plus graves de plongée mais aussi un des plus faciles à éviter. Il peut se produire à une faible profondeur, c'est-à-dire à partir de 5 mètres.
Lors d’une plongée, la pression environnante augmente fortement. C’est cette pression qui engendre des risques barotraumatique pour le corps humain. Dans l’eau, la pression augmente de 1 bar tous les 10 mètres. Par exemple, sur le bâteau, la pression atmosphérique est de 1 bar, à 10 mètres de profondeur elle est de 2 bars, à 20 mètres de 3 bars, etc. Lors de la descente, la pression augmente et les poumons du plongeur se contractent. Leur volume diminue fortement : tous les 10 mètres il est divisé par 2 jusqu'à atteindre le volume résiduel des poumons. Ainsi, lors des 10 premiers mètres, le volume des poumons est divisé par 2. Le phénomène inverse se produit à la remontée : lors de la remontée des 10 derniers mètres, le volume des poumons du plongeur double.
Si la respiration du plongeur est bloquée lors de la remontée, le volume de ses poumons augmente au même moment très rapidement. Cela crée une forte dépression dans ses poumons, et engendre une dilatation des alvéoles pulmonaires. Celles-ci se distendent et peuvent même se déchirer. L’air présent dans les poumons peut alors pénétrer dans les vaisseaux sanguins sous forme de bulles d’air via les capillaires pulmonaires déchirés. Il s’agit d’embolies gazeuses. Les bulles d’air peuvent alors circuler dans le réseau sanguin et, en passant par le cœur, s’installer dans les artères cérébrales. Cela engendre une perte de lucidité, voire une perte de connaissance.
D’autres formes de traumatisme peuvent également survenir, par exemple le pneumothorax. Il s’agit d’une déchirure de la plèvre, l’enveloppe qui entoure les poumons. La pression reste alors au niveau de la cage thoracique, ce qui peut empêcher la personne de respirer. Un autre type de traumatisme possible est un pneumo médiastin, ou la déchirure du médiastin. Celui-ci est situé dans la cavité entre les poumons. Une fois déchiré, l’air peut y circuler. Quand l’air remonte à travers cette cavité, des bulles d’azote peuvent apparaître sous la peau. Lorsque l’air redescend à travers cette cavité, les bulles d’azotes vont se refugier au niveau de l’abdomen. La direction de l’air dépend de la position du tronc de la personne à ce moment-là.
Le blocage de la respiration peut être causé par un spasme de la glotte. La glotte fait partie du larynx et se situe au fond de la bouche, entre les cordes vocales. Un spasme de la glotte peut survenir en cas de malformation ou lorsque l’écoulement de l’air est perturbé par des substances étrangères présentes dans les poumons, telles que le goudron pour les fumeurs. Les malformations sont souvent dues à la présence de ganglions localisés trop près des bronches. La présence de ces ganglions et la dépression dans les poumons va déclencher une obturation des bronches, qu’on appelle alors bronches à clapet. Le spasme peut également être engendré par une forte perturbation de l’écoulement de l’air. En surface, l’écoulement de l’air est laminaire. Sous l’eau l’écoulement de l’air est turbulent, c’est-à-dire plus difficile et moins « fluide ». L’air est plus dense et s’échappe plus lentement des poumons. L’échappement de l’air est encore plus difficile quand les poumons contiennent des substances étrangères. Par exemple, le goudron pour une personne qui fume ou le mucus quand une personne est atteinte d’une infection pulmonaire. La perturbation marquée de l’écoulement de l’air peut conduire à un spasme de la glotte qui coupe la respiration du plongeur.
La loi de Boyle-Mariotte:
De manière physique, la loi de Boyle-Mariotte peut expliquer le phénomène de la surpression pulmonaire. En 1676, Boyle-Mariotte énonce la loi de compressibilité des gaz :
« A température constante, le volume d’un gaz est inversement
proportionnel à la pression qu’il reçoit. »
La video ci-dessous illustre cette loi physique. Nous pouvons effectivement constater l’effet de la pression sur une balle de tennis qu’un plongeur amène à 15 mètres de profondeur puis remonte à la surface.
La dépression pulmonaire:
La dépression pulmonaire est un autre phénomène plus rare qui peut survenir lors d’une plongée profonde, c’est-a-dire à plus de 70 mètres. Il s’agit d’une réduction de la fréquence et de l’amplitude respiratoire, avec des regonflements d’apnée. A partir de 70 mètres, ou 8 bars de pression, le volume d’air dans les poumons atteint le volume d’air résiduel (represente par le numero 4 sur le schema), c'est-à-dire que le volume minimum d’air dans les poumons. La pression continue d’augmenter sur le thorax et la pression dans les poumons devient inferieure à celle de l’eau. Ceci engendre un effet de « vide » dans les poumons. Le sang présent dans les gros vaisseaux et les capillaires pulmonaires va alors venir remplir ce vide grâce à la circulation pulmonaire. C’est le phénomène du « Blood shift ».
Il faut noter que ces barotraumatismes pulmonaires ne se produisent pas en apnée car le plongeur contrôle le taux d’air inspiré et expiré. La pression est donc équilibrée naturellement par le corps.
Dans le cas de John, nous pouvons écarter la dépression pulmonaire car il n’a pas plongé à une profondeur supérieure à 70 mètres. Il s’agit donc d’un cas de surpression pulmonaire. Des bulles d’air ne sont pas apparues sous la peau ou dans l’abdomen, donc il ne s’agit pas d’un traumatisme du médiastin. Il a des douleurs au niveau des poumons et des difficultés à respirer. Il pourrait s’agir d’un pneumothorax, ou rupture de la plèvre. Mais d’autres symptômes sont apparus : problème de lucidité, vision et perte de connaissance. Ils reflètent un problème au niveau cérébral. Il s’agit donc d’embolies pulmonaires, des bulles d’air qui ont atteint des artères cérébrales.
Quelle est la raison du blocage de sa respiration ? John est en bonne santé et ne fume pas. Ses poumons ne contiennent pas de substances étrangères. Donc il ne s’agit pas d’un blocage du a l’écoulement turbulent de l’air. Il n’a d’autre part aucune malformation du système respiratoire. Les deux autres causes possibles sont donc l’apparition d’eau froide dans le système respiratoire ou un possible moment de panique de John qui aurait alors bloqué sa respiration lors de la remontée.
Les barotraumatismes des poumons son fréquents en plongée. Les conséquences peuvent être graves. Ils sont en revanche faciles à éviter. Il suffit de respirer calmement et continuellement lors de la remontée.
Le Dauphin a des poumons de forme allongée, ils s’étendent en avant de la première côte et en arrière de la deuxième ou troisième vertèbre, contre un diaphragme musclé et très incliné. Les poumons sont enveloppés dans une plèvre épaisse, résistante et très riche en tissu élastique.
Le diaphragme du dauphin
Le dauphin a des nombreuses particularités histologiques pulmonaires, ceci est dû à une formidable adaptation à la plongée en apnée et aux échanges gazeux rapides dont il est capable lorsqu’il remonte à la surface.
Le parenchyme pulmonaire est le tissu fonctionnel des poumons, il est diffèrent de celui de l’Homme par ses structures de support important : le cartilage, le collagène, les fibres musculaires lisses et le tissus élastiques. Ces structures offrent au dauphin la capacité de résister aux fortes variations de pression en permettant aux alvéoles de se collaber.
Au repos la fréquence respiratoire du dauphin varie en fonction de sa taille, son métabolisme et son mode de vie. La fréquence respiratoire est en moyenne de deux à trois cycles par minute. Le dauphin est en apnée entre chaque cycle.
La respiration du dauphin fait intervenir trois phases.
-
La phase expiratoire, elle est passive et a lieu lorsque le dauphin émerge. Lors de cette phase, l’évent s’ouvre, les sacs aériens sont comprimés et les voies nasales dilatées.
-
La phase inspiratoire, elle est active, rapide et bruyante. A la fin de cette phase, l’évent se referme.
-
La phase d’apnée, elle sépare chaque cycle respiratoire. Elle dure habituellement 20 à 40 secondes mais peut durer jusqu’a 1 ou 2 minutes pendant le sommeil et se prolonger pendant 6 à 7 minutes lors de la plongée.
Avant une plongée le dauphin effectue 10 à 20 cycles respiratoires.
L’aptitude respiratoire du dauphin est supérieur à celle de l’Homme par la souplesse de sa cage thoracique et par l’abondance du tissu élastique pulmonaire. Chaque cycle respiratoire du dauphin a une efficacité d'au moins quatre fois supérieure à celle de l’Homme.
D’après la loi de Boyle, un volume de gaz varie inversement à la pression qui lui est exercé.
Chez le dauphin, le volume pulmonaire présente environ 10 litres en surface soit 1 litre à 100 mètres de profondeur. L’anatomie de la cage thoracique du dauphin ainsi que celle de son diaphragme permettent cette souplesse.
Lors de la plongée, le volume pulmonaire diminue et il se produit un afflux sanguin appelé « érection pulmonaire » ou « blood shift ». Cet afflux sert à durcir les vaisseaux et les capillaires entourant les poumons et les alvéoles pulmonaires, ce qui donne une résistance aux effets de la pression sur l’organisme.
Au cours de la descente la pression hydrostatique augmente et le volume pulmonaire diminue. Ensuite la pression intra thoracique devient négative par rapport à celle du milieu aquatique environnant. Le sang présent, dans les gros vaisseaux et les capillaires pulmonaires, est aspiré puis retenu dans la circulation pulmonaire remplissant le vide de la cage thoracique. Cela contribue à rigidifier le poumon et lui permet de supporter des pressions encore plus importantes.
Video qui explique la loi de Boyle Mariotte:

Schéma des différents volumes d'air dans les poumons:

Schéma des différentes parties des poumons:
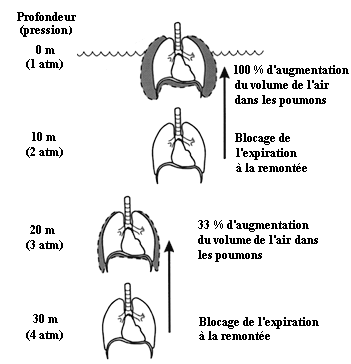
Explication du barotraumatisme au niveau des poumons lors de la descente:

John et sa famille avant d'effectuer une plongée en Thailande


Tableau de comparaison
Video Dauphin et Plongeurs